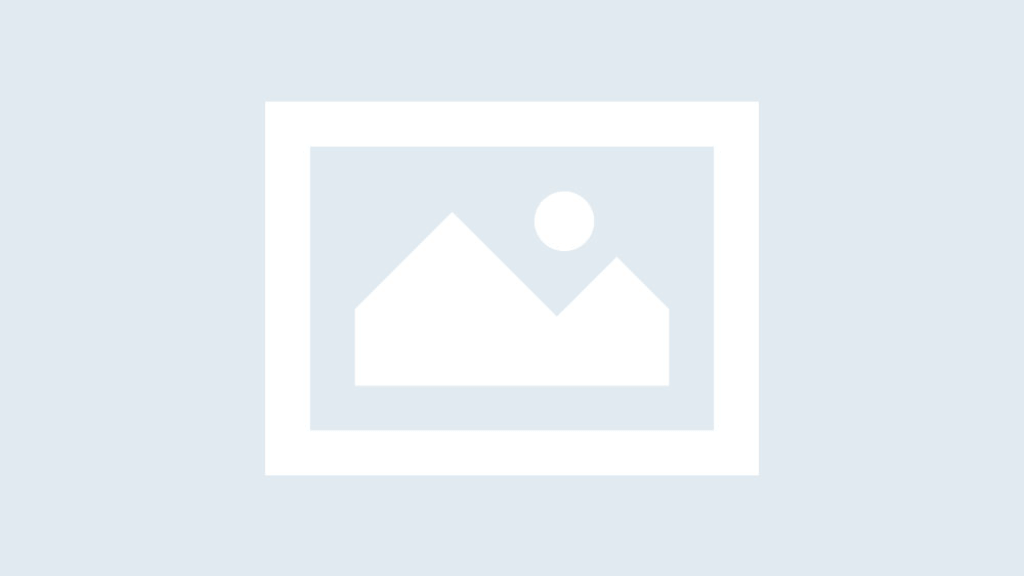La Chine a arrêté l’an dernier une trentaine de pasteurs et de membres de l’Eglise de Sion dans plusieurs régions chinoises dont la capitale Pékin. Tous ont été conduits à Beihai, ville située sur le golfe du Tonkin, au nord-ouest de la mer de Chine méridionale.
Cette église est l’une des plus grandes congrégations protestantes non enregistrées du pays. Elle est dirigée par le pasteur Jin Mingri, également connu sous le nom d’Ezra Jin. Il fait face à des accusations criminelles en vertu du Code pénal de la République populaire de Chine liées à « l’utilisation illégale des réseaux d’information ».
La Constitution chinoise qui garantit la liberté de croyance exige que toute pratique publique soit enregistrée auprès des autorités et soumise à leur contrôle. Toute activité en dehors de ce cadre – qu’il s’agisse de rituels privés à domicile ou de prédications en ligne – est considérée comme « illégale », exposant ainsi ses auteurs à des poursuites judiciaires.
Cheval de Troie et siècle de l’humiliation
Concernant l’Église de Sion et les institutions similaires, implantées à partir de 2007, le problème dépasse ces dimensions « organisationnelles », s’orientant vers une perspective sécuritaire qui perçoit l’activité religieuse informelle – en particulier celle liée aux réseaux externes – comme un « cheval de Troie » susceptible d’infiltrer le tissu social de l’État et de saper sa stabilité.
La Chine a étudié avec attention la longue tradition occidentale de prosélytisme religieux pour infiltrer ses adversaires sur les plans social et politique, et craint que cette expérience ne se reproduise sur son propre sol, compte tenu de la facilité d’accès sans précédent offerte par le numérique.
Cette perception est profondément ancrée dans la mémoire collective chinoise, remontant au « siècle de l’humiliation », qui s’étend du milieu du XIXe siècle au milieu du XXe siècle. Cette période constitue l’un des piliers fondateurs du récit nationaliste moderne. Ce récit renforce l’idée que la perte de souveraineté chinoise n’était pas uniquement le résultat d’une défaite militaire, mais aussi le fruit d’incursions politiques et culturelles accumulées au fil du temps. Ceci explique pourquoi l’État se concentre sur les dangers d’infiltration extérieure sous ses formes « non militaires », dont le prosélytisme religieux est considéré par les Chinois comme faisant partie.
Dans la conscience historique chinoise, les missionnaires occidentaux n’étaient pas perçus comme des guides spirituels, mais plutôt comme faisant partie intégrante du système impérialiste occidental.
Dans leur étude intitulée « Missionnaires et modernisation en Chine », les chercheurs Jiaoli Yan et Zhigang Wang soulignent que l’arrivée des missions, coïncidant avec les défaites des « guerres de l’opium », a renforcé la croyance que la croix était transportée par les navires de guerre.
D’autant que ces missions étaient protégées par le système des « traités inégaux », qui accordaient aux missionnaires et à leurs sujets chinois le droit d’« extraterritorialité », c’est-à-dire la soumission aux lois de leurs pays occidentaux plutôt qu’au droit chinois.
Les puissances occidentales ne se contentaient pas de protéger les missionnaires ; elles les utilisaient fréquemment comme instruments stratégiques pour étendre leur influence politique, culturelle et juridique en Chine. Les gouvernements et les entreprises commerciales occidentales employaient des missionnaires comme traducteurs et intermédiaires, car ils étaient souvent les seuls étrangers à maîtriser le chinois. Certains missionnaires, comme Wells Williams et A.B. Martin, ont joué un rôle direct dans la rédaction des clauses de « tolérance religieuse » des traités de 1858. Ces clauses ont par la suite fourni un fondement juridique aux puissances occidentales pour s’ingérer dans les affaires intérieures de la Chine sous couvert de protection de la liberté religieuse.
Les traités accordaient aux missionnaires le droit d’acheter des terres et de construire des églises, ce que de nombreux Chinois considéraient comme une atteinte au tissu géographique et culturel du pays et une extension de l’influence étrangère.
Ecoles numériques er préoccupations sécuritaires
Par conséquent, pour Pékin, la question semble aller au-delà des explications toutes faites de « contrôle idéologique » et soulève de véritables préoccupations sécuritaires quant à une atteinte réelle à son tissu social.
L’église de Sion avait été fermée une première fois en 2018, à l’issue d’une campagne menée par l’Etat chinois à partir de 2009.
Les autorités avaient interdit l’Église évangélique de Wanbang à Shanghai, puis, en 2011, elles ont imposé des restrictions à l’Église de Shuwang à Pékin, l’empêchant d’obtenir un siège et assignant son pasteur, Jin Tianming, ainsi que sa famille, à résidence surveillée. En 2014, le gouvernement chinois a lancé une campagne visant à retirer les croix des toits des églises. L’année suivante, l’Église de la Pierre Vivante (Living Stone Church) à Guiyang, capitale de la province du Guizhou, a été interdite et ses biens confisqués.
Mais la fermeture en 2018 de l’Église de Sion, devenue l’une des plus importantes organisations religieuses chrétiennes non officielles, n’a pas sonné le glas de son existence. Bien au contraire, elle l’a incitée à se repositionner, s’éloignant d’une structure institutionnelle rigide, notamment dans le domaine numérique durant la pandémie de COVID-19. Cela lui a permis de se développer en marge du contrôle gouvernemental et de maintenir la communication entre ses membres, ainsi que d’étendre son réseau à de nombreuses villes sans siège central ni statut officiel.
Son essor via des « écoles numériques » a incité Pékin à promulguer une nouvelle loi en septembre dernier, limitant la diffusion d’enseignements en ligne aux seules plateformes agréées et restreignant les activités religieuses non autorisées. Les critiques estiment que ces mesures violent l’article 36 de la Constitution chinoise, qui stipule clairement que « les citoyens de la République populaire de Chine jouissent de la liberté de croyance religieuse ». Le gouvernement, quant à lui, affirme que ces mesures relèvent pleinement de la compétence du Bureau d’État des affaires religieuses, chargé de superviser et de réglementer les affaires religieuses dans le pays.
Lien étroits avec la CIA
Le prosélytisme numérique préoccupe Pékin qui craint qu’il ne se limite pas à la diffusion de contenu religieux mais établit une activité transnationale susceptible de détourner les citoyens de l’État. Comme cela s’est passé dans certains pays d’Amérique latine.
En 1980, la journaliste Penny Lernow révéla dans le magazine The Nation les liens étroits entre la CIA et les missionnaires, notamment en Amérique latine. Lernow documenta comment la religion servait de couverture à l’espionnage, au recrutement d’informateurs, et même à la mise en œuvre d’opérations de « propagande noire » et à la discréditation d’opposants politiques hostiles aux dictatures pro américaines, comme ce fut le cas en Uruguay, en Équateur, au Brésil, au Chili…
Son rapport explique que la coopération entre l’agence américaine et les missionnaires et membres du clergé était courante jusqu’en 1975, ces derniers étant utilisés comme informateurs ou pour des missions secrètes. Quatorze cas importants, principalement en Amérique latine, sont documentés. Le rapport souligne que ces pratiques n’étaient pas marginales, mais faisaient partie intégrante des outils opérationnels de l’agence dans des contextes politiques extrêmement sensibles.
La Chine ne persécute pas les membres de l’Église de Sion simplement parce qu’ils prient chez eux ou font du prosélytisme, mais parce que – aux yeux de l’État – ils représentent une « brèche numérique » dans le mur de souveraineté, ravivant les cauchemars du XIXe siècle. Alors que le monde glisse rapidement vers une confrontation potentiellement ouverte entre grandes puissances, Pékin ne considère plus ces réseaux avec une simple méfiance historique, mais comme une menace directe et imminente pour sa sécurité.
Traduit en résumé du site d’al-Jazeera